Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Vous êtes-vous déjà demandé qui était Agnès Varda ? Son nom, donné à l’amphithéâtre du bâtiment A3 de l’UFR, figure sur nos emplois du temps et nous passons quasiment quotidiennement devant sa plaque dans le hall. Donner son nom à des lieux permet aujourd’hui d’entretenir la mémoire de celle qui est décédée d’un cancer à l’âge de 90 ans en 2019. Mais il est également important de comprendre la femme qu’elle était.

Agnès Varda fut l’une des rares réalisatrices ayant une place dans le cinéma français entre les années 1950 et 1960. Unique figure féminine du courant de la Nouvelle Vague, elle se démarque de Jean-Luc Godard, François Truffaut ou encore Éric Rohmer en proposant une alternative au regard masculin dans le cinéma et en axant ses scénarios sur des destins de femmes combattives et entreprenantes. Elle inaugure l’ère de la Nouvelle Vague en 1955 à la sortie de son premier film La Pointe Courte, avant ses confrères.
Un autre film marquant de sa carrière est Cléo de 5 à 7, sorti en 1962. Le film suit en temps réel Cléo, une chanteuse insouciante et frivole qui craint d’être atteinte d’un cancer, en train d’attendre ses résultats d’examens médicaux dans Paris. Au cours du film, Cléo passe du statut d’objet de consommation (la chanteuse de variété) à celui de sujet questionnant son reflet et celui des autres ; elle se met à regarder. Dans son essai To Desire Differently: Feminism and French Cinema paru en 1990, Sandy Flitterman-Lewis note à propos de la protagoniste : « Elle cesse d’être un objet construit par le regard des hommes, et assume le pouvoir de regarder. » Agnès Varda déplace le regard cinématographique sur le féminin. Naît quelques années après la sortie de Cléo de 5 à 7, dans les années 70, une réflexion impulsée par Laura Mulvey dans son ouvrage Visual Pleasure and Narrative Cinema sur la place accordée aux femmes dans les œuvres cinématographiques.

Agnès Varda suit ce schéma dans son film féministe et musical L’un chante, l’autre pas, paru en 1977. Elle y relate l’histoire du droit des femmes en y dénonçant notamment la charge mentale ainsi que la politique anti-avortement, avant la loi Simone Veil de 1975. La réalisatrice a d’ailleurs signé le manifeste des « 343 salopes » de 1971, à côté de noms comme Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir ou encore Catherine Deneuve, annonçant publiquement avoir avorté clandestinement et risquant sa carrière.
Agnès Varda ne limite pas son féminisme au cadre narratif de ses œuvres et milite activement pour revaloriser les femmes dans ce milieu encore très masculin. Face à ce problème, elle crée sa propre société de production en 1954, Ciné Tamaris, pour avoir davantage de contrôle autour de ses films. En respectant le principe de parité sur ses tournages, elle a donné 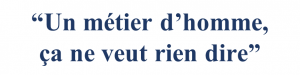 des postes de responsabilité à de nombreuses femmes, dont Nurith Aviv, la première cheffe-opératrice de France. Elle dénonce activement sur les plateaux télé et dans ses interviews les schémas sexistes de l’attribution des rôles dans le métier du cinéma. La réalisatrice souhaite mettre en valeur les ingénieures du son, les cadreuses, les directrices de photographie, … et regrette que les femmes soient cantonnées aux métiers de maquilleuses et coiffeuses sur les plateaux.
des postes de responsabilité à de nombreuses femmes, dont Nurith Aviv, la première cheffe-opératrice de France. Elle dénonce activement sur les plateaux télé et dans ses interviews les schémas sexistes de l’attribution des rôles dans le métier du cinéma. La réalisatrice souhaite mettre en valeur les ingénieures du son, les cadreuses, les directrices de photographie, … et regrette que les femmes soient cantonnées aux métiers de maquilleuses et coiffeuses sur les plateaux.
Agnès Varda n’a jamais eu peur de revendiquer haut et fort son féminisme, et ce dès les années soixante. Elle prône la colère, le droit de la révolte et assume un féminisme radical. La réalisatrice ne perd pas son sang-froid sur les plateaux télé, entourée d’hommes, et décrit les oppressions que subissent les femmes.
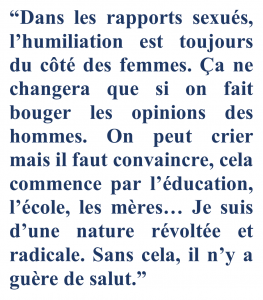 Grande humaniste, elle appelle également à la solidarité féminine et refuse la compétition. « Je trouve que je prends un peu trop la lumière alors qu’il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont du talent » déclare-t-elle lors d’une conférence en juillet 2018. Elle profite de son statut de grande réalisatrice reconnue pour partager le spotlight avec des femmes moins connues du public, passées sous silence, comme Alice Guy-Blaché, la première réalisatrice et productrice de l’histoire du cinéma. Elle organise avec Cate Blanchett, lors du festival de Cannes de 2018, un « happening » où 80 femmes du monde du cinéma, peu connues, montent les marches à leur côté. Dans un discours prononcé peu après, les deux femmes demandent « l’équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels ».
Grande humaniste, elle appelle également à la solidarité féminine et refuse la compétition. « Je trouve que je prends un peu trop la lumière alors qu’il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont du talent » déclare-t-elle lors d’une conférence en juillet 2018. Elle profite de son statut de grande réalisatrice reconnue pour partager le spotlight avec des femmes moins connues du public, passées sous silence, comme Alice Guy-Blaché, la première réalisatrice et productrice de l’histoire du cinéma. Elle organise avec Cate Blanchett, lors du festival de Cannes de 2018, un « happening » où 80 femmes du monde du cinéma, peu connues, montent les marches à leur côté. Dans un discours prononcé peu après, les deux femmes demandent « l’équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels ».
Agnès Varda a revendiqué ce féminisme radical jusqu’à son décès. Elle ne s’est jamais désolidarisée de ce mouvement ; elle a fortement soutenu #MeToo et insistait sur la nécessité de continuer le combat. Elle défendait notamment une éducation sexuelle et une instruction du féminisme dans les écoles.
« Encore aujourd’hui, j’ai honte qu’il y ait dans ce monde des femmes excisées, battues, violées. Ça me révolte profondément. Ça ne se tasse pas avec l’âge. »
