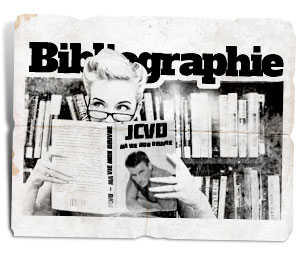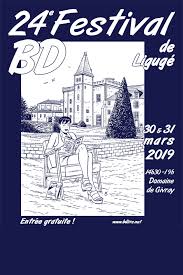FICHE DE LECTURE
FICHE DE LECTURE
Le livre : que faire ?
De R. Alberto, F. Combes, J. Faucilhon, E. Hazn, H. Korb, F. Salbans, A. Schiffrin, J. Vidal
La Fabrique éditions, janvier 2008.
Résumé & Analyse
Cette œuvre s’ouvre sur un chapitre intitulé Assez de larmes, écrit par Eric Hazan, un éditeur et un écrivain, ayant dirigé cet ouvrage collectif qui regroupe des entretiens et des textes, en faveur de la défense du livre indépendant.
En effet, il fait appel à différents acteurs de la chaîne du livre pour présenter une réflexion et proposer des solutions concernant la situation du livre, et plus spécifiquement encore, sur celle du livre dit d’indépendant. A partir de là, il établit un constat sans appel : celui de « la disparition du livre indépendant comme programmée ». Il fait alors état d’une distinction très nette entre « le livre produit par l’industrie de « l’Entertainment » et le livre issu de l’édition artisanale ». Cette opposition est d’ailleurs indispensable pour comprendre la situation problématique du livre en général.
Il ne tarde pas non plus à balayer les arguments des instances institutionnelles tels que la baisse des lecteurs, la concurrence de l’internet et le livre électronique. Pour lui, il s’agit de constats faciles et superficiels. Le véritable problème reposant sur la concentration de la presse et de l’édition, qui provoque une industrialisation massive, qui va de pair avec une hyperproduction des publications. Il dénonce aussi la puissance conséquente et polémique de la prescription médiatique et ce qu’il surnomme lui-même comme « la décrépitude de la critique de livres ». Cette démission collective apparait donc comme la véritable menace planant sur le monde du livre, d’où le titre de l’œuvre : Le Livre : que faire ?
C’est pourquoi, le but premier de cet ouvrage est « d’apporter des embryons de réponses ». Il ne s’agit ni d’un manuel ni d’un traité à vocation dogmatique. Il serait plutôt question, selon l’expression consacrée de Michel Foucault, d’une « boite à outils ». Tous les auteurs convoqués dans ce livre, apportent des témoignages et des solutions concrètes sur la librairie, l’édition, la diffusion, le numérique, le droit d’auteur ou encore la distribution du livre indépendant. A mon avis représentatif de l’essence du livre et présentant les différentes parties qui composent l’ouvrage, je me permets de rapporter les propos exacts d’Eric Hazan :
« Dans ce livre, André Schiffrin suggère de nouvelles formes d’édition permettant à de petites structures de ne pas être étranglées par les contraintes des banques et du marché. Francis Combes propose une conception du droit d’auteur qui permettrait à ceux qui tentent de vivre de leur plume de ne plus être assimilés à des petits commerçants. Jérôme Vidal expose ce que pourrait devenir l’aide publique au livre indépendant. Roland Alberto expose les forces et les faiblesses d’une librairie quand elle met ses exigences au plus haut. Frédéric Salbans démontre la nécessité d’une diffusion indépendante à côté des mammouths du secteur. Hélène Korb explique comment une bibliothèque municipale devrait aider les petits éditeurs et les librairies du quartier. Enfin, Joël Faucilhon étudie l’impact de l’internet et des nouvelles technologies, et comment ils peuvent servir à l’indépendance du livre. »
En mettant ainsi en évidence la dichotomie qui existe entre le livre indépendant, le fruit d’un travail artisanale, et le livre industriel dont la principale inquiétude reste le rendement, Eric Hazan montre le caractère nécessaire du livre indépendant et comment améliorer sa situation.
Des presses universitaires sans universités
Dans une seconde partie, c’est au tour de l’éditeur et écrivain André Schiffrin, d’intervenir. Il écrit sur les presses universitaires sans universités. Son postulat est énoncé clairement en sous-titre : « Maintenir l’édition indépendante ».
Il part d’un constat grinçant, celui du contrôle politique des médias. En effet, notamment sous la présidence Sarkozy, la majorité des médias est contrôlée par des groupes comme Dassault et Lagardère, dont le principal client est l’Etat. L’auteur parle même d’un nouveau modèle de contrôle, entre Poutine et Berlusconi. Il prend ainsi l’exemple de Serge Dassault qui a expliqué avoir acheté Le Figaro parce que ce journal exprimait ses opinions, au risque de supprimer la liberté d’expression des journalistes, en rédigeant lui-même, par exemple, les éditoriaux. Par conséquent, pour contrer cela, il présente l’édition indépendante comme vitale. Elle seule se bat pour préserver son autonomie politique et culturelle. En outre, cette-dernière dispose de plusieurs avantages, dont son fonctionnement artisanal, sans apport important de capital, et le soutien relativement modeste qu’elle demande. Néanmoins, André Schiffrin explique aussi que la manière de mettre sur pied une maison d’édition indépendante est tout aussi difficile que de la maintenir en vie. C’est pourquoi il propose plusieurs solutions comme la location d’un local aux municipalités ou aux universités, l’édition à but non lucratif comme celle de The New Press qui repose sur le soutien de fondations et qui permet d’éditer sans compromettre la qualité intellectuelle des livres, ou encore les presses universitaires et les coopératives.
Enfin, il termine par rappeler que la plupart des médias devaient avoir un rôle culturel et pédagogique à leur création, et qu’on ne peut, en aucun cas, se passer du soutien de l’Etat. Il souligne aussi qu’il s’agit de questions qui doivent mobiliser l’opinion publique par l’enjeu qu’elles représentent.
Quelques réflexions hétérodoxes
Dans un autre registre, Francis Combes propose plusieurs réflexions sur les fondements même du système.
Il prend le temps de définir le droit d’auteur et ses limites. Sur ce point, la législation française fonctionne mal. Il soulève ainsi deux problèmes majeurs, celui du financement de la création et celui de la rémunération de l’auteur. Sans exclure l’idée du don de l’œuvre ou de la gratuité, il écrit que tout repose sur un point de vue économique. On retrouve des notions comme « concurrence » ou « marché » pour parler du livre. L’exemple du salaire inégal de l’auteur est particulièrement parlant : celui-ci se base uniquement sur les ventes et le travail de l’écrivain n’a pas de valeur propre. Par conséquent, la problématique soulevée est la suivante : « Il faut bien en effet, du moins tant que l’argent et les rapports marchands se maintiennent, trouver le moyen de financer la création et de rémunérer les auteurs. La question est de savoir comment. » Il imagine alors des solutions comme l’intervention de l’aide publique qui serait établie sur des nouveaux critères ou encore un pourcentage de droits sur les ventes des ouvrages appartenant au domaine public.
Les points aveugles d’une politique
Le traducteur et éditeur Jérôme Vidal, défend dans une quatrième partie, une « mise en œuvre et un approfondissement d’une démocratisation culturelle exigeante », afin de soutenir la création et la bibliodiversité.
Par ce biais, il va s’intéresser à l’aide publique au livre indépendant, aussi bien au niveau régional qu’au niveau national. Il propose donc des solutions pour contrecarrer ce qu’il nomme « les éditeurs de l’oligopole en réseau de l’édition ». Il leur reproche « leur stratégie d’inondation du marché par la multiplication de livres de qualité médiocre, leur politique de prédation à l’égard des petits éditeurs indépendants, les contraintes que font peser les processus de concentration et de monopolisation sur l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre, la recherche d’une rentabilité maximale et immédiate, le développement, à travers les grandes surfaces spécialisées, d’une librairie sans libraire. » De ce fait, il souhaite renouveler les critères de l’aide publique à l’égard du livre indépendant, pour préserver la bibliodiversité et la légitimité des subventions. Il remet notamment en cause les procédés du Centre National du Livre, qui pour lui doit faire preuve de plus de transparence et communiquer sur ses ressources, son organisation et ses activités. Par la suite, il soulève deux nouvelles problématiques : les pratiques de lecture à l’école et le manque de préparation vis-à-vis du numérique.
Chaque livre relié aux autres par un fil de rencontres et de lectures
La cinquième partie de l’ouvrage est un entretien mené par Eric Hazan, avec le libraire Roland Alberto. Exigeant et passionné, ce-dernier y explique son fonctionnement, son quotidien ainsi que les difficultés qu’il rencontre.
En effet, il doit sans cesse trouver un juste milieu entre les best-sellers plébiscités par la critique et les médias (à tort ou à raison) et d’autres livres, plus difficiles à défendre, car n’ayant pas eu la même publicité. Il confie qu’il « détourne » le client, plutôt qu’il le conseille dans le cadre de sa profession. En revanche, concernant les relations qu’il entretient avec l’éditeur, il reconnait qu’il est plus facile et plus enrichissant, de collaborer avec des maisons d’édition indépendantes qui savent aller au-delà de la représentation commerciale. Quant aux problèmes qu’il rencontre, le plus important et aussi le plus basique, reste le loyer. En effet, pour toutes libraires de centre-ville, cette problématique représente la difficulté majeure. Ensuite, viennent les frais de transports pour toutes structures ne se trouvant pas dans l’axe Paris-Lyon-Méditerranée. Autre problème soulevé, celui des aides et des subventions, dont les dossiers sont particulièrement complexes à monter. En ce qui concerne les marchés publics, le libraire Roland Alberto insiste sur le fait qu’ils pourraient être améliorés, notamment en les limitant à deux par librairie, ce qui permettrait une redistribution plus juste et aiderait les librairies indépendantes. Au travers de cet entretien, on constate donc que les problèmes décris sont bien souvent des évidences qui pourraient être solutionnées aisément. De nouveau, comme le faisait remarquer Eric Hazan au début du livre, on se retrouve face à une certaine forme de démission de la part des instances publiques.
Accompagner le développement d’éditeurs singuliers
Dans le chapitre suivant, le lecteur découvre un nouvel entretien avec Frédéric Salbans, un directeur commercial, spécialisé dans la diffusion et la distribution du livre.
Lui aussi commence son propos par un constat négatif, celui de l’industrialisation massive. Il en parle comme d’un processus déstabilisant l’édition et la librairie indépendantes. Nous nous situons en plein dans un système où 90% de la distribution est industrielle, rationalisée et robotisée, cela à grande échelle. Ainsi, pour qu’un libraire indépendant ne se retrouve pas obligé de subir, il doit s’adapter à ce modèle capitaliste de distribution. Dans ce but, Frédéric Salbans propose deux solutions : d’abord, mutualiser les coûts financiers du transport et réduire la part de ces coûts dans le budget des librairies, et ensuite, créer une sorte de banque qui gérerait tous les comptes fournisseurs. En ce qui concerne la diffusion, il parle du rôle majeur du représentant et de la relation particulière qu’il entretient avec le libraire. Enfin, il souhaiterait une intervention des pouvoirs publics, comme cela se fait parfois dans le milieu du cinéma, pour que le livre ne finisse pas par être considéré comme une simple marchandise.
Défendre les petites librairies du secteur
L’avant dernière partie de l’ouvrage porte sur les rapports entretenus par les bibliothèques avec l’univers du livre indépendant. Pour cela, Eric Hazan interroge Hélène Korb, bibliothécaire à Gennevilliers.
Profession en pleine mutation, de nouveaux critères entrent désormais en ligne de compte chez les bibliothécaires. Il y a la concentration massive des livres imposés par la pression médiatique et l’actualité, et la nécessité que les gens lisent pour les bibliothèques, qu’il s’agisse ou non, de mauvaise littérature. Il s’agit là de la première difficulté du métier, c’est-à-dire « parvenir à l’équilibre entre ce que nous voudrions défendre et ce que nous demandent les gens sous l’influence des médias ». Un des autres obstacles rencontrés est la formation non adaptée des professionnels, généralement peu à l’aise avec l’ensemble de la chaîne du livre. En outre, les acquisitions des bibliothèques varient selon la couleur politique des villes dont elles sont issues. Hélène Korb explique par exemple que sous une commune de gauche, les œuvres portant sur les sciences sociales et humaines seront plus demandées. On retrouve donc toujours cette idée que la politique est partie prenante dans le milieu du livre, de la culture. Il en va de même pour les budgets d’achats et les subventions, ce sont les services financiers qui ont le dernier mot. Quant aux principales difficultés que rencontre le livre indépendant avec les bibliothèques, elles reposent sur des procédures d’appel d’offres qui ne sont pas équitables et le fait que l’essentiel de la diffusion passe dorénavant sur internet, ce qui lèse les petites librairies dont la production n’est pas forcément très représentée. De plus, les plus grosses structures sont favorisées car elles possèdent tous les éléments comptables et administratifs nécessaires à la composition d’un dossier. C’est pourquoi, dans le but de solutionner ces problèmes, Hélène Korb présente cinq propositions : premièrement, la modification de la procédure d’appel d’offres avec la proximité comme critère, ensuite que les possibilités d’achats hors marché soient plus importantes pour passer de 1% du budget actuellement à 10%, troisièmement, l’élaboration d’une loi sur les bibliothèques définissant les missions et les besoins et qui garantirait l’indépendance par rapport aux politiques, puis une formation des professionnels plus approfondie avec une étude de la création contemporaine et des enjeux de l’édition, et enfin, un travail sur la transversalité entre les différents secteurs du livre.
Un monde d’informaticiens et de manutentionnaires ?
Le dernier chapitre du livre est écrit par Joël Faucilhon qui a fondé une association, Lekti-écriture, qui offre sur internet un espace à plus d’une cinquantaine d’éditeurs indépendants. L’auteur aborde donc le rapport entre le livre indépendant et les nouvelles technologies.
Le postulat de cette dernière partie repose sur le souhait de contrer le risque de la marchandisation du savoir, justement opposé à l’idée du « bien commun ». En effet, si Internet permet de faire découvrir à un public élargit des textes qui sont moins sous les feux des projecteurs, il n’en reste pas moins que la profusion des informations ne laisse plus place à l’assimilation. Par ailleurs, c’est la publicité qui régit le web et les sites les mieux référencés sont ceux qui vendent des espaces publicitaires. Une des autres problématiques posées par la toile est la vente des livres par internet. On peut citer l’exemple d’Amazon qui a le monopole et qui oblige les éditeurs à mettre leurs livres en dépôt permanent avec une marge atteignant les 50%. Pour se battre contre ça, les librairies indépendantes doivent inventer leur propre modèle, en mettant en valeur leur rôle de conseil et le facteur humain. Idéalement, ils devraient transposer leur métier sur Internet. Il est aussi question du livre numérique, associé à un lecteur donné, et qui de ce fait, oblige le lecteur à s’en tenir à une seule source pour l’achat de ses livres.
Conclusion & Commentaire
En somme, ce recueil de textes et d’entretiens met en avant la défense du livre indépendant et les différentes mesures, tous secteurs confondus, pouvant servir à contrer l’industrialisation du livre. En effet, la véritable menace qui pèse sur l’univers du livre, ce sont toutes ces mutations commerciales qui tendent à en faire une simple marchandise. En outre, et là encore quel que soit le milieu, qu’il s’agisse de celui des libraires, des bibliothécaires, des éditeurs, certains problèmes sont récurrents. On peut citer la politique qui empiète beaucoup trop dans les choix de lectures et qui en même temps, fait preuve d’une grande inertie quand il s’agit de faire évoluer les choses. Il y a aussi la dimension économique qui désormais prend le pas sur tout le reste, le marketing ayant effacé tous les repères. Les fortes inégalités existantes entre les petites structures et les grosses entreprises, se répercutent même dans la constitution des dossiers pour les subventions. Les organismes publics comme le Centre National du Livre manquent de transparence et il y a très peu de communication entre les différents secteurs du livre. Nombreuses sont les solutions proposées dans cet ouvrage qui pourraient être mises en place facilement et qui répondraient aux besoins immédiats et sur le long terme. L’État pourrait, entre autre, reconnaître que les libraires et les éditeurs contribuent à remplir une mission de service public. En résumé, cet ouvrage collectif s’appuyant sur des témoignages concrets d’acteurs engagés de la chaîne du livre, montre les solutions possibles pour conserver l’esprit artisanal du livre tout en s’adaptant aux nouvelles technologies et à la demande. Il est clairement énoncé que le temps n’est plus aux lamentations, mais à l’action.